Qu’est-ce qu’une vie ratée ? Voilà une drôle de question. Elle est drôle non seulement parce qu’elle semble indigne (comment peut-on (se) demander cela ?) mais aussi parce que se la poser c’est déjà se dire que sa propre vie rentre pour le moins dans les critères d’un ratage de champion. Et dans une société où la réussite, la richesse, la jeunesse, la tyrannie du bonheur sont les nouvelles Idoles, poser cette question est un véritable blasphème. Se demander si on a raté sa vie c’est faire injure aux soubassements mêmes de notre société post-moderne, qui érige la volonté, l’autonomie, l’idée que nous sommes seuls les maîtres de notre destin en Muses de toutes les existences humaines, qu’elles le veuillent ou non.
Nous voulons tous plutôt savoir quels sont les ingrédients d’une vie réussie, qui, selon nos standards actuels, se mesure aux nombres de fois où l’on fait l’amour et au nombre de partenaires que l’on a eus dans sa vie, à la Joie hypocrite que l’on affiche sur les réseaux sociaux avec ses chers enfants ou à la puissance d’agir que l’on manifeste au quotidien dans sa vie professionnelle, dans sa vie de bénévole pour des organisations qui ont du sens, dans sa vie amicale avec des personnes de qualité, dans sa vie qui NE doit surtout pas être ratée.
Bref, une telle question n’est tout juste pas audible aujourd’hui. 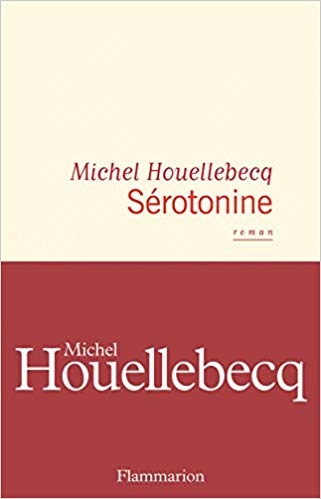
Le pessimisme fait rire
Et pourtant, c’est cette question que pose inlassablement Michel Houellebecq dans son œuvre. Il raconte, au fil de ses pages, des destins ordinaires, poisseux, cyniques et morbides, et c’est ce qui fait de ses romans de parfaites images de notre monde. Notre société est ordinaire, poisseuse et morbide et elle veut par tout un système cosmétique, qui va de l’hyper consommation à la politique spectacle, nous faire croire que nous vivons une expérience extraordinaire. C’est pour cela que Michel Houellebecq est tant admiré et surtout détesté, détesté surtout par ceux et celles qui savent que leurs vies est ratée, mais qui veulent continuer à faire semblant, coûte que coûte. C’est ce qu’il appelle, dans son nouveau roman, Sérotonine, les « bobos écoresponsables ».
Pour ma part, je suis une fan de Michel Houellebecq, non seulement du personnage qu’il a créé ou qu’il est (je ne sais pas faire la différence entre les deux, ce sera à lui de nous dire s’il y une différence) et de ses romans. Ayant écrit mon mémoire de maîtrise de philosophie sur les liens entre le pessimisme de Arthur Schopenhauer et d’Emil Cioran (deux auteurs cités dans tous les romans de Houellebecq), je ne peux être que charmée par le ton de l’auteur qui, comme une page d’un de ses deux philosophes, me fait toujours autant rire. Quoi ? Lire Schopenhauer, Cioran ou Houellebecq me fait rire ? Si ce n’est pas le cas pour vous, j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : vous avez raté votre vie !
Ce que nous raconte Michel Houellebecq est bien autre chose que des histoires de loosers, et en cela ses romans sont politiques. Il nous raconte bien plus l’histoire de notre société à l’agonie, dans laquelle nos vies ne peuvent être que ratées, puisqu’elles s’articulent dans un environnement toxique dès le départ. C’est ce que l’on peut nommer une civilisation en décadence : comment dès lors, pourrions-nous vivre une vie bonne et joyeuse alors que le milieu qui nous porte dans son sein est malade ? Comment pourrions-nous avoir une vie sentimentale et sexuelle stable et épanouie quand notre monde fait de la pornographie et du « moi d’abord » des indépassables ? L’amour est juste l’exact contraire de ces deux piliers actuels, ce qui revient à dire qu’avoir une relation amoureuse est impossible à l’heure où tout se jauge, se juge et s’évalue sur des applications mobiles. Il y a alors deux solutions qui s’offrent à nous : ou bien, comme la majorité des humains sur cette planète, nous jouons se jeu pervers et nous faisons semblant, avec pour une part non négligeable de personnes la certitude qu’ils vivent bien et que leurs vies sont réussies. Ils se prennent au sérieux. Ou bien, on devient pessimiste, cynique, voire nihiliste. La différence considérable entre ces termes se trouve, à mon sens, que le nihilisme moderne (né en Russie au XIXe siècle) est, comme la solution précédente, une posture plus qu’un mode de vie, une posture de dandy qui se prend au sérieux. Le pessimisme, en tout cas celui que l’on retrouve chez Cioran comme chez Houellebecq, est une forme d’ironie qui ne peut aboutir, quand on va au bout, qu’à un énorme éclat de rire sur la tragédie que l’on vit.
« Les histoires d’amour finissent mal… en général »
Dans son nouveau roman, Sérotonine, Michel Houellebecq raconte la vie de Florent-Claude (!), un ingénieur agronome, employé contractuel du Ministère de l’Agriculture, qui décide, pour se débarrasser de sa compagne du moment, Yuzu (!), une Japonaise superficielle, de disparaître volontairement de la surface du monde. Il ne se réfugie pas très loin de son appartement du quartier Beaugrenelle, dans des hôtels parisiens qui acceptent encore les fumeurs. Son odyssée est pour le narrateur l’occasion de raconter sa vie, surtout sa vie sentimentale, faite de rencontres avec des femmes, dont la plus importante aura été Camille. Pour résumer sa vie, nous pourrions dire que Florent-Claude a des « jobs à la con » (surtout quand il travaille pour Mosanto) c’est-à-dire vide de sens, et même donc parfois contraire à ses propres valeurs, que ses amours sont passables sauf une fois, avec la fameuse Camille, mais que cet amour finit, lui aussi. Le narrateur n’a pas de vraie passion dans la vie, il fume, il boit, il couche et il gagne bien sa vie, mais il n’a pratiquement aucun bien matériel, ne s’intéresse pas vraiment à la culture et n’a pas de vie sociale. Plus qu’un looser, Florent-Claude est un mec normal, un homme du XXIe siècle. En tout cas, il est moins paumé que les autres antihéros houellebecquiens, et je l’ai trouvé plus « attachant » car beaucoup plus crédible à mon sens.
Dans sa cavale hors du monde « normal », Florent- Claude essaye de retrouver les traces de son passé, en l’occurrence de son ami de l’Agro, où ils firent leurs études : Aymeric d’Harcourt, brillant aristocrate normand, que Florent-Claude retrouve en miettes dans son château transformé en ferme d’élevage laitier. Abandonné par sa femme et ses enfants, couverts de dettes à cause de la fin des quotas laitiers européens, Aymeric monte sur les barricades de la fureur des paysans, qu’aujourd’hui on voit se cristalliser chez les Gilets Jaunes. Aymeric devient alors le martyr de ce collectif, qui ressemble beaucoup à la descente aux enfers de nos propres vies individuelles.
Puis le narrateur essaye de retrouver son vrai et seul amour, Camille, devenue vétérinaire en Normandie. On trouve là, sous la plume de Houellebecq, des accents d’un romantisme qui pourrait paraître étrange dans le langage d’un cynique comme lui. Mais en fait, le cynisme et le nihilisme ne naissent-ils pas, aussi, des douleurs d’amours perdues et trahies ?
J’ai beaucoup aimé ce nouveau roman de Michel Houellebecq, car j’y retrouve l’humour noir qui me permet de tenir, parfois, les jours gris. D’ailleurs, je me suis demandé un instant si Houellebecq et son éditeur ne faisaient pas exprès de publier ses romans toujours au mois de janvier, en début d’année, quand la terre est morte, le ciel bas et morose, les températures froides et les arbres nus. Il faut lire Houellebecq un dimanche après midi d’hiver quand dehors tout est repoussant et déprimant. Si on le lisait à la fin de l’été, pour la rentrée, on ne pourrait pas voir la sombre réalité qu’il nous décrit et qu’il a le courage de nous forcer à regarder droit dans les yeux.
En savoir plus sur Bisogna Morire
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
Hmm… Je n’ai pas lu Houellebecq encore, j’hésite, car la façon dont il dépeint les femmes et les homosexuels va m’énerver, je le sens. Je n’ai pas encore lu Cioran, par contre j’ai un avis très tranché sur le cynisme : pour moi, c’est juste l’humour des fatalistes qui ne veulent rien foutre… Tu me diras que c’est un peu sévère, mais c’est ce que j’observe autour de moi. On me conseille tout de même de lire Cioran, peut-être que c’est différent ! Il faudra bien que je me mette à lire Houellebecq un jour aussi…
En tout cas, chronique intéressante 🙂
J’aimeJ’aime